La notion de territoire au-delà de la définition anglophone
The Wiley Blackwell Companion to Political Geography
octobre 2015
The Wiley Blackwell Companion to Political Geography vise à rendre compte des développements intellectuels et mondiaux qui ont eu lieu dans et autour de la géographie politique au cours des dix dernières années. L’ouvrage met en lumière des débats théoriques et conceptuels provocateurs sur la géographie politique à partir d’un éventail de perspectives mondiales. Dans le chapitre 4, Cristina Biaggio illustre les variations géographiques et culturelles du sens du mot « territoire », au-delà de sa définition anglophone stricte.
À télécharger : article_version_imprimee.pdf (87 Kio)
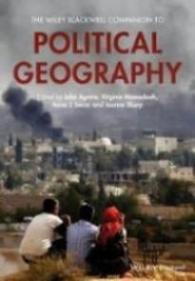
« Les territoires comptent toujours », même dans un monde globalisé, affirme Antonsich (2009 : 789). Paradoxalement, le territoire n’a jamais été autant discuté qu’au cours des dernières décennies, au moment même où les relations internationales semblent de moins en moins régies par lui (Badie 1996 : 114). C’est particulièrement paradoxal si l’on considère que le terme de territoire coïncide avec celui de territoire d’État, comme c’est le cas la plupart du temps dans la géographie anglo-saxonne. Il est moins paradoxal pour les géographes francophones, car leur conception du territoire n’a jamais été aussi strictement liée aux frontières nationales que celle de la géographie anglophone, dans laquelle, comme le suggère Antonsich, « le territoire, au lieu d’être exploré dans les nouvelles conditions de la mondialisation, a simplement été écarté avec l’État-nation lui-même » (2009 : 795). En fait, seuls quelques universitaires ont écrit sur le territoire dans la géographie anglophone, notamment Soja (1971), Gottmann (1973) et Sack (1983 ; voir Paasi 2003 ; Elden 2010a, 2010b ; Dell’Agnese 2013).
Le territoire, cette « chose » que Cox considère comme le « concept central de la géographie politique » (Cox 1991), n’est pas tout à fait le même pour les universitaires qui écrivent en anglais et ceux qui écrivent en français. Et cette affirmation va au-delà d’une simple différence lexicale. Ce n’est pas seulement que le territoire francophone est souvent traduit par le « lieu » anglais et non par « territoire », comme le sens commun le suggère. C’est aussi parce que la différence est épistémologique et que, de ce fait, cette différence entre territoire et territory ouvre la porte à de nouvelles perspectives de recherche qui seront en partie révélées par cet article. Les perspectives francophones sur le concept de territoire ont été et sont encore larges. En fait, Klauser rappelle dans son introduction au numéro spécial de Environment and Planning D, en rendant hommage à la conception de la territorialité de Raffestin, comment les travaux de Raffestin visaient à construire une théorie de la territorialité, qui, écrit-il, est « en fin de compte une ‘théorie du réel’ » (Klauser 2012 : 109-110). Les tentatives de Raffestin et d’autres géographes francophones de saisir la relation entre les êtres humains et le monde à travers le territoire reflètent donc une conception plus large du territoire par rapport à celle des universitaires anglophones. Ces derniers se concentrent sur deux idées principales :
-
La première est une « [lecture] de la territorialité … qui concerne, principalement, l’étude des stratégies eopolitiques d’ontrol/défense de l’espace et les arrangements politico-territoriaux qui en résultent » (Klauser 2012 : 110). Cela amène Taylor à déclarer que « dans l’ensemble de notre monde moderne, le territoire est directement lié à la souveraineté pour façonner la politique en un processus social fondamentalement centré sur l’État » (Taylor 1994 : 151 ; voir aussi Dell’Agnese 2013). Un État territorial est un « simple » conteneur de pouvoir, de richesse, de culture et de société (Taylor 1994 : 152 ; voir aussi Elden 2010b : 757 ; Taylor 1995 : 1).
-
La deuxième notion anglophone est une interprétation du territoire comme une transposition des théories éthologiques dans les sciences sociales, à la suite du livre d’Ardrey The Territorial Imperative (Ardrey 1966 ; voir aussi Murphy 2012 : 159). Cette idée a notamment été introduite en géographie par des chercheurs tels que Soja (1971) et Gottmann (1973 ; Murphy 2012 : 159), mais aussi par Sack, qui a toutefois « traité la territorialité humaine comme fondamentalement distincte de la territorialité animale en ce sens que la première n’est pas le produit de l’instinct mais est plutôt un processus culturellement situé destiné à atteindre des objectifs politiques et sociaux particuliers » (Murphy 2012 : 160-161).
Pourtant, comme le souligne Debarbieux (1999 : 34), en français comme en anglais, le territoire a la même étymologie latine et le terme a connu une évolution similaire dans les deux contextes : Il a d’abord pris un sens juridico-politique (le territoire de l’État) puis éthologique (la zone appropriée par un animal ou un groupe d’animaux). Ce n’est que dans les années 1970 et 1980 que la signification s’est scindée. Alors que les géographes anglophones ne détachaient pas le territoire de l’État, les géographes francophones considéraient que le territoire avait des connotations multiples. La tradition francophone s’est donc enrichie en matière de territoire à partir des années 1970.
Les universitaires anglo-saxons n’ont redécouvert que récemment la pertinence du territoire, tandis que le territoire français enrichit la recherche depuis plus de 30 ans. Afin de découvrir la « manière francophone » de comprendre le territoire, je commence par analyser le processus de construction de la région alpine. Dans cette section, la pertinence des territoires est examinée, en introduisant la notion (pas nécessairement) opposée de réseaux. A partir de cet exemple concret, je discute de la manière dont les territoires doivent être considérés comme des espaces délimités, mais pas nécessairement étatiques. La troisième section traite de la pertinence de considérer le territoire francophone comme équivalent au lieu anglophone. Tant les territoires que les lieux sont conçus comme des entités capables, notamment en raison de la propension des acteurs à construire des réseaux, d’échapper au « piège territorial » (Agnew 1994). Cependant, si, d’un point de vue épistémologique, le lieu en anglais a le même effet que le territoire en français - c’est-à-dire qu’il aide à penser le
unités au-delà de leur signification juridictionnelle - le lieu et le territoire ne peuvent être considérés comme équivalents. Le territoire a une plus longue histoire dans la géographie francophone, bien qu’il n’ait pas encore été concrétisé dans l’étude anglophone du territoire. Ainsi, dans la cinquième section, les différences entre le territoire francophone et le territoire anglophone seront discutées, en mettant l’accent sur le sens francophone. La sixième section expose une sorte de typologie, proposée par Giraut (2008), dans laquelle le territoire est lié entre deux extrémités : une notion spécifique, liée à l’État, et un mot à la mode, lié aux usages sociaux et culturels de l’espace. Cette dernière partie du chapitre montrera comment le territoire a permis à la géographie francophone de devenir une science sociale et de sortir de sa conception centrée sur l’État.
L’étude de cas des Alpes
Les processus sociaux et politiques qui se déroulent dans les Alpes peuvent être interprétés dans le cadre plus général du rétrécissement du niveau national, qui a rendu possibles de nouvelles configurations scalaires (Swyngedouw 2004 : 132) et des périmètres alternatifs de coopération (Häkli 2008 : 475). Dans les Alpes, l’un des phénomènes les plus intéressants qui s’est produit depuis les années 1990 est la mise en place de réseaux d’acteurs politiques locaux. L’histoire commence en 1991, lorsque les huit États alpins ont signé un traité international appelé la Convention alpine. L’Union européenne (UE) a ensuite financé un programme de six ans (2007-2013) pour promouvoir la coopération transnationale dans les Alpes afin d’encourager le principe principal de la convention, le développement durable.
Ces initiatives, identifiées par certains scientifiques comme étant « top-down » (Bätzing 1994), ont établi un cadre qui a permis aux projets locaux, « bottom-up », de gagner en importance. Elles ont souvent pris la forme de réseaux pan-alpins, impliquant, entre autres, des municipalités, des villes, des stations de ski, des zones protégées et des entreprises. Les membres de ces réseaux sont des acteurs politiques locaux agissant à une échelle commune donnée, en l’occurrence dans les limites de la Convention alpine, et transcendant les frontières administratives nationales existantes. Tout en proposant un nouveau mode d’interaction, le réseau issu de ces activités et institutions a également fixé de nouvelles frontières territoriales, celles de la région alpine telle que définie par la Convention alpine. Ces processus, « d’en haut » et « d’en bas », illustrent le point théorique de Paasi (2003 : 112) lorsqu’il suggère que c’est exactement la combinaison de processus descendants et ascendants qui crée des territoires.
Ces deux formes différentes de modus operandi, vertical et horizontal, qui se déroulent dans les Alpes sont utiles pour comprendre les liens entre les réseaux et les territoires. Les réseaux, en effet, ont un effet sur la géographie. La question est analysée par le géographe français Fourny, dans le cadre de ses recherches sur le réseau de la Ville des Alpes de l’Année. Fourny a observé, en examinant la rhétorique du réseau, qu’un changement de statut du territoire de référence avait eu lieu. Le réseau « Ville des Alpes de l’Année » fait référence aux Alpes pour justifier son action commune et son rôle dans la gestion de cet espace. Ce faisant, selon Fourny (1999 : 179-180), les villes alpines, reliées par un réseau, contribuent à construire politiquement le territoire alpin, à créer un espace public, objet d’un débat collectif. Grâce à l’activité du réseau, un processus de redéfinition des territoires d’action, et donc de redéfinition des frontières, est également en cours, parallèlement à la renégociation des identités collectives. On peut le constater dans les activités des projets de coopération de l’UE, tels qu’INTERREG. En fait, comme l’admet Bray (dans Keating 2004 : 12), ils « ont contribué à redéfinir les frontières comme des zones complexes dans lesquelles de multiples identités peuvent être exprimées et négociées » et où les identités sont mises en œuvre dans des actions et des projets.
Tout en réalisant des projets et des actions en réseau, les nouveaux types de coopération horizontale qui ne sont plus liés aux anciennes unités territoriales dessinent de nouvelles géographies, comme le soutient Leitner (dans Marston, Jones, & Woodward 2005 : 417) : « les réseaux transnationaux représentent de nouveaux modes de coordination et de gouvernance, une nouvelle politique de relations horizontales qui ont également une spatialité distincte ». Ou, comme le souligne Bulkeley (2005 : 888), les activités des réseaux ne sont pas en dehors de leurs frontières, dans « la manière dont ils fonctionnent et la façon dont ils sont encadrés, configurés et cristallisés ». Si cela est vrai, Allen et Cochrane (2007) suggèrent que les acteurs, afin de pouvoir gouverner ces « entités transgressantes », doivent également d’une manière ou d’une autre fixer ces nouveaux espaces d’action. Cela crée une tension entre la nécessité d’étendre les activités au-delà de limites données et la nécessité de fixer ces mêmes activités afin de les gouverner. Cette conception des territoires et des réseaux rappelle la double observation de Bulkeley (2005 : 888) selon laquelle, d’une part, les frontières scalaires sont fluides et contestées et, d’autre part, les réseaux sont à la fois, et contrairement à ce que l’on pense généralement, délimités. Cette reconnaissance, espère Bulkeley, « peut servir de base à la poursuite d’un dialogue constructif » entre les deux concepts (2005 : 888).
Les deux notions de réseaux et de territoires semblent coexister dans, comme le dit Bulkeley, « de nouveaux espaces en réseau » (2005 : 897). Celles-ci confirment que « les échelles géographiques et les réseaux de connectivité spatiale peuvent être considérés comme des aspects mutuellement constitutifs plutôt que mutuellement exclusifs de la spatialité sociale » (Bulkeley 2005 : 888). En effet, Bulkeley souligne le fait que « les réseaux, les échelles et les territoires ne sont pas des alternatives, mais sont intimement liés à la fois dans une politique d’échelle et dans la création de nouvelles arènes d’autorité et de légitimité politiques » (2005 : 896).
Elle utilise l’exemple de la gouvernance du changement climatique, mais d’autres exemples pourraient être utilisés pour illustrer ce lien entre réseaux et territoires. Cela nous ramène à l’idée d’Elissalde (2002 : 195), qui soutient que, d’une certaine manière, les territoires sont des réseaux, sans toutefois nier que des arrangements spatiaux fluides et sans limites n’exigent pas « une plus grande fixité et une plus grande délimitation » (Murphy 2012 : 170).
Le concept de « réseaux d’échelle » proposé par Leitner, Sheppard et Sziarto (2008b : 287 ; Leitner, Pavlik et Sheppard 2008a : 162) semble approprié pour répondre à la critique de Bulkeley concernant la double vision des échelles et des réseaux. Dans le cas des Alpes, l’échelle de la Convention alpine est la référence utilisée par les acteurs politiques locaux, mais leurs activités sont ancrées dans des réseaux reliant différents points de l’échelle alpine. Ainsi, il est utile de considérer les Alpes comme un espace géographique non pas couvrant mais plutôt couvrant (Leitner et al. 2008a : 162 ; Leitner et al. 2008b : 287), puisqu’il combine des processus d’échelle avec des processus de mise en réseau. Elle démontre qu’il est utile de penser en termes de co-construction de réseaux et de territoires.
Transgresser les espaces délimités ?
L’idée de considérer les réseaux et les territoires comme des entités co-construites n’est possible que si le territoire n’est pas nécessairement conçu comme un état borné, une idée qui semblait inimaginable pour les géographes anglophones, du moins jusqu’à l’arrivée de l’idée d’un territoire et d’un espace relationnel, défendue, entre autres, par Massey (2004 ; voir Dell’Agnese 2013). Pourtant, le territoire peut être considéré en termes d’espace délimité, même s’il n’est pas nécessairement délimité par l’État. Dans ce cas, une question soulevée par Elden (2010a : 12-13) reste sans réponse : Qu’est-ce que cet espace (délimité) et comment ces limites sont-elles possibles ? On peut trouver deux réponses dans la littérature.
Premièrement, cet espace pourrait être l’unité de référence dans un monde imaginé comme un patchwork formé par des formes géométriques bidimensionnelles qui ne se chevauchent pas, où chaque unité présente une intégrité (ou homogénéité) interne et une identité distincte (Painter 2009 : 57, 2010 : 1091). Ceci n’est pas sans analogie avec les observations faites dans les sociétés animales, où le territoire est exclusif aux membres d’une même espèce et est limité par une frontière (Bonnemaison 1981 : 253). C’est normalement la vision du monde qu’ont les spécialistes qui considèrent le territoire comme une prérogative de l’État, où les territoires sont délimités par des frontières claires (Painter 2010 : 1094). Ainsi, l’intégrité de cet espace serait assurée par le partage du même espace national. Ce serait la vision privilégiée par les géographes anglophones.
La deuxième possibilité correspond mieux à la compréhension francophone du territoire et pourrait être considérée comme le domaine des pratiques et des relations quotidiennes. Dans ce cas, les limites géographiques sont définies par la surface où celles-ci se déroulent (Raffestin in Bonnemaison 1981 : 260).
Les universitaires francophones partagent ce point de vue avec d’autres géographes de tradition anglo-saxonne. Cox, par exemple, considère que le territoire n’est pas limité uniquement par des limites juridictionnelles. Pour lui, sa délimitation pourrait être comprise dans un sens plus large comme des « zones délimitées » capables de contenir toute relation sociale (Cox 1991 : 5-6). Le territoire, dans ce sens, est le conteneur de relations sociales et/ou de pouvoir (non invariablement étatiques) localisées (Cox 1991 : 6 ; Agnew 1999 : 503).
Si les deux options sont valables, surtout si l’on tient compte de la tradition épistémologique dans laquelle elles sont insérées, des problèmes se posent néanmoins lorsqu’elles sont considérées simultanément, comme le fait Jaillet (2009 : 115) en disant que « le territoire désigne à la fois une circonscription politique et l’espace de vie du groupe ». Or, ces deux espaces ne sont pas toujours spatialement équivalents. C’est pour cette raison que les géographes anglophones ont tourné le dos au territoire et ont préféré le « lieu » à la place : précisément parce que le territoire était considéré comme un espace délimité, c’est-à-dire borné par les frontières nationales (Antonsich 2009 : 790). C’est en fait l’une des raisons plausibles que Painter cite pour expliquer la raison pour laquelle les géographes anglophones, ressentant une certaine « gêne » par rapport au territoire, ont décidé d’opter pour d’autres concepts (Painter 2010 : 1091). Partant de là, les géographes anglophones distinguent le « sens du territoire » du « sens du lieu » en accordant plus d’importance à la seconde option qu’à la première :
« La littérature sur le sens du lieu accorde peu d’importance à la délimitation spécifique du lieu. Le sens du territoire, cependant - au moins aussi lié aux régimes de légitimation territoriale - est inextricablement lié au système d’État moderne et, à ce titre, porte l’empreinte de la logique territoriale du système. (Murphy 2002 : 197-198) »
Territoire = lieu ?
C’est dans les années 1970 et 1980 que le territoire a pris de l’importance dans la géographie francophone, ce qui correspond au moment où la dimension symbolique du territoire a commencé à être essentielle en géographie, où les chercheurs ont commencé à penser en termes d’appropriation et d’espace vécu. C’est à partir de ce moment que les chercheurs anglophones ont convergé vers le concept de « lieu ». Le lieu, dans le monde anglo-saxon, a donné aux géographes la possibilité d’introduire les dimensions sociales, culturelles et politiques de l’espace et a fourni une critique du territoire politique, de sa délimitation rigide et de son contrôle par l’État (Debarbieux 1999 : 42). Cela a permis à Debarbieux (1999 : 42) de dire que les significations données au terme « place » dans la géographie anglophone rappellent les innovations qui se produisent dans la géographie francophone avec le territoire.
Les termes « place » et « sense of place » ont ainsi aidé les géographes anglophones à dépasser le « piège territorial », un terme qu’Agnew a inventé pour reconnaître les hypothèses géographiques sur les États : notamment qu’il s’agit d’unités fixes de souveraineté, qu’il existe une polarité entre les politiques « intérieures » et « étrangères », et que les États sont simplement des « conteneurs de sociétés » (Agnew 1994). Cependant, comme le rappelle Elden (2010b : 757), le « piège » n’est pas le territoire lui-même, mais plutôt « certaines manières de penser le territoire ». Et, comme le regrette Elden (2010b : 760), le « piège territorial » a été évité par le simple fait de ne pas être mentionné dans les textes scientifiques au lieu d’être interrogé de manière critique. Il est donc important de « souligner l’hypothèse erronée selon laquelle les spatialités du pouvoir de l’État et du territoire de l’État sont homomorphes » (Painter 2010 : 1095). L’analyse des réseaux territoriaux est l’une de ces « voies de sortie du « piège territorial » » que Bulkeley (2005 : 881) identifie.
Si, comme nous l’avons vu plus haut, le lieu épistémologique en anglais a le même effet que le territoire en français, le lieu est souvent traduit en français par lieu, un concept qui nécessite des explications supplémentaires. Le lien entre lieu et territoire dans la géographie francophone est bien repris dans un article de Debarbieux (1995 : 14) consacré à cette question : « Métaphoriquement, le lieu symbolise le territoire, mais le lieu est aussi un métonyme ou, plus exactement, une synecdoque, le tout, le territoire, peut être dit par ses parties, le lieu ». La théorie de Debarbieux rejoint celle de Di Méo (1998 : 110), « la lisibilité géographique » : Le territoire est abstrait, idéal, vécu et ressenti plus que détecté et limité visuellement ; le territoire comprend les lieux, qui sont définis, par opposition aux territoires, par leur réalité frappante due à leur « valeur d’usage ». Or, poursuit Di Méo (1998 : 108), si les lieux diffèrent du territoire sur ces points, ils convergent dans le fait qu’ils sont tous deux des espaces qualifiés par la société (ou « sémiotisés », comme dirait Raffestin). Debarbieux (1995 : 14-15) découvre le lien entre lieu et territoire de manière similaire, en affirmant qu’un territoire est une construction sociale qui relie une base matérielle constituée d’un espace géographique à un système de valeurs qui donne des significations multiples et combinées à chaque composante de cet espace (les lieux, mais aussi les espaces et les discontinuités qu’il englobe).
Lieux comme Di Méo les désigne - c’est-à-dire comme des espaces de pratique quotidienne - sont considérés comme relativement petits : ils sont définis par la contiguïté des points et des toiles qui les composent, par la co-présence d’êtres humains et de choses qui véhiculent un sens spatial (Di Méo 1998 : 108). Les Lieux peuvent être si denses de sens qu’ils relient en même temps deux échelles géographiques : celle de l’emplacement (location) et celle du territoire auquel ils se réfèrent (Debarbieux 1995 : 14). Lieux, donc, sont simultanément non seulement des fragments de territoires, mais aussi des figures capables de révéler leur quintessence (Debarbieux 1995 : 14). Tel que conçu par Debarbieux et Di Méo, le lieu implique donc une différence essentielle par rapport au « lieu » : « Le lieu, à la différence du territoire, abolit la distance ; alors que le territoire géographique abhorre les frontières, le lieu y puise sa substance » (Di Méo 1998 : 108).
Territoires en réseau et réseaux territoriaux
Ainsi, le territoire peut être conçu comme une échappatoire aux frontières en général et aux frontières nationales en particulier :
Les pratiques spatiales, les modes de production et d’utilisation de l’espace, ont profondément changé. En particulier, tant les États territoriaux que les acteurs non étatiques opèrent désormais dans un monde où les frontières étatiques sont devenues culturellement et économiquement perméables aux décisions et aux flux émanant de réseaux de pouvoir qui ne sont pas captés par des représentations singulièrement territoriales de l’espace. (Agnew 1994 : 72)
L’exemple le plus emblématique de cette tendance est l’expression trop souvent utilisée d’« économie mondiale » ou « global », termes employés pour indiquer que les flux monétaires circulent dans le monde entier sans être arrêtés par aucune frontière d’État. Indubitablement, ces tendances sociopolitiques influencent la manière dont les chercheurs en sciences sociales en général et les géographes en particulier reconnaissent les liens entre les territoires et les réseaux, bien que ces liens soient conçus de manière différente dans la géographie anglophone et francophone.
L’un des principaux et plus intéressants contributeurs anglophones à ce débat est certainement Painter, qui a abordé la question dans deux articles (2009, 2010), dans lesquels il défend la thèse selon laquelle le territoire et le réseau ne sont pas « comme on le suppose souvent, des principes incommensurables et rivaux de l’organisation spatiale, mais sont intimement liés » (Painter 2010 : 1093-1094).
Dans la géographie francophone, la possibilité que les réseaux et les territoires soient connectés, ou fortement intégrés, a un héritage plus ancien. Déjà en 1981, Bonnemaison (1981 : 254) écrivait que « la territorialité couvre à la fois ce qui est fixe et ce qui est mobile, c’est-à-dire les itinéraires autant que les lieux ». Trois ans plus tard, Raffestin et Turco (1984 : 45) affirment presque la même idée avec leur définition du territoire comme produit de l’espace à travers les réseaux, les circuits et les flux projetés par les groupes sociaux. Elissalde (2002 : 195) s’appuie sur des articles publiés dans les années 1980 pour affirmer, 20 ans plus tard, qu’« une géographie des territoires ne peut être limitée à l’étude de surfaces délimitées ou emboîtées ; les territoires sont des réseaux », ajoutant « … et pas seulement pour les nomades » (c’est-à-dire aussi dans les sociétés occidentales). Elissalde (2002 : 197) trouve qu’il est aussi inutile d’opposer territoire et réseaux que d’éviter d’imaginer des frontières floues et des territoires qui se chevauchent. Cette conception des territoires n’est cependant possible que si l’on considère les territoires au-delà de leur signification juridictionnelle.
L’étude du cas alpin montre la fécondité de cette approche, car elle pousse les chercheurs à concevoir les territoires non seulement comme de simples « entités spatiales données » fixées par des unités administratives, mais comme des portions d’espace construites et flexibles. Cette conception a cependant été analysée plus en profondeur par les géographes francophones que par les anglophones. Une exception est l’article de Painter, dans lequel il propose de « repenser le territoire » en utilisant un grand nombre de sources francophones longtemps ignorées par les universitaires anglophones (Klauser 2012 : 107). Ce faisant, il comble un vide que Fall (2007) attribue au fait que, pour des raisons institutionnelles surtout, les théoriciens prospères du territoire, dont le géographe suisse Raffestin, n’ont jamais osé dépasser les frontières francophones. Mais quelle est cette « conception francophone » des territoires ? Ce qui suit a pour but de répondre à cette question.
Le territoire francophone versus le territoire anglophone
En ce qui concerne le territoire, deux voies différentes ont été suivies, deux voies distinctes ne profitant pas d’une éventuelle fertilisation mutuelle. Comme l’a déclaré Chamussy (2003 : 168), « Il n’existe toujours pas, pour l’instant, d’équivalent anglais du mot territoire tel qu’il est compris par les géographes francophones ». Ainsi, la devise de Painter (2010 : 1090) « le territoire est de retour » n’a de sens que dans la géographie anglophone, car dans la tradition francophone, le territoire n’a jamais disparu.
Painter semble cependant conscient de son anglo-centrisme lorsqu’il écrit que « jusqu’à récemment, le concept de territoire n’a pas reçu le même niveau d’attention, du moins dans la littérature anglophone » (Painter 2010 : 1091) ; bien que le territoire soit un concept clé dans un article qu’il a écrit avec Bialasiewicz et Elden (Bialasiewicz et al. 2005), dans lequel ils l’analysent à travers la lentille du Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Grâce à cet exemple, les trois chercheurs ont trouvé utile de comprendre le territoire d’une manière plus « francophone », c’est-à-dire en allant au-delà de sa conception centrée sur l’État. Ils soulignent que le territoire est au centre du processus d’intégration européenne et que l’intégration européenne permet précisément de transcender « les notions existantes de territoire, en particulier celles associées à l’État-nation » (Bialasiewicz et al. 2005 : 335).
Alors, qu’est-ce que les géographes francophones entendent par territoire ? Historiquement, le territoire a fait irruption dans la géographie francophone lorsque des dimensions culturelles et symboliques ont été introduites dans le concept suite à l’intérêt croissant des géographes sociaux et politiques pour des concepts tels que « pouvoir », « contrôle spatial », « différenciation », « domination » et « appropriation sociale » (Alphandéry & Bergues 2004 ; Claval 1996 : 96 ; Debarbieux 2003 : 38). L’accent mis sur le territoire correspond à la revendication de la géographie d’appartenir aux sciences sociales et de se démarquer d’une conception naturaliste ou mathématique de la géographie (Douillet 2003 : 215). Le territoire a remplacé le concept de région d’abord et d’espace ensuite (Chamussy 2003 : 167 ; Debarbieux 2003 : 36-37) et ne s’attache pas à l’idée que le territoire se termine nécessairement là où les États le font, comme c’est le cas pour le « territoire » anglais (Debarbieux 2003 : 35, 42). La perspective anglophone est bien résumée dans cette déclaration : « Le territoire représente l’étendue du pouvoir souverain de l’État » (Forsberg 2003 : 13). Les invitations de Sack (1983), Cox (1991) et Agnew (1999) à rompre avec la nécessité d’analyser le pouvoir et le contrôle à travers le prisme de l’État n’ont pas encore porté leurs fruits dans l’étude anglophone du territoire.
Lié entre deux pôles : Une notion spécifique ou un mot à la mode ?
Giraut résume assez bien cette tradition francophone « plus riche », en identifiant deux pôles auxquels le concept est lié : une notion spécifique, correspondant à la zone de l’État (national), comme pour les géographes anglophones, et un mot à la mode, correspondant à une zone non spécifiée (Giraut 2008 : 59). Ces deux tendances sont également distinguées par Alphandéry et Bergues (2004) : d’une part, un territoire issu du maillage historique et, d’autre part, un territoire prenant différentes formes dans l’espace, qui est produit et transformé par des personnes et des groupes de personnes. Cette dernière approche est une façon plus diffuse et moins institutionnalisée de concevoir le territoire et elle recouvre l’idée qu’un territoire, dans la mesure où il est tel, doit être approprié par des individus ou des groupes d’individus. L’appropriation peut être concrète et/ou symbolique (Bourdeau 1991 : 30).
Giraut, dans son analyse, place l’idée d’appropriation non pas comme une forme possible que peut prendre le territoire (maillage historique ou espace transformé par des personnes, comme pour Alphandéry et Bergues), mais comme le concept utilisé par les géographes culturels pour analyser les identités ou par les géographes politiques pour signifier le pouvoir et le contrôle. Les géographes francophones ne conçoivent pas toujours le pouvoir comme nécessairement lié au pouvoir étatique, puisque le pouvoir est conçu comme inhérent à toute relation sociale (Tizon 1996 : 27 ; Giraut 2008 : 60 ; Ozouf-Marignier 2009 : 35).
L’« appropriation » a également joué un rôle important dans les débats entre les partisans de l’espace et les partisans du territoire. Le premier, l’espace, est principalement utilisé par les urbanistes et les technocrates qui le considèrent comme un donné, quelque chose de « plat », d’« uniforme » et de « sans mystère » (Bonnemaison 1981 : 260). Le second, le territoire, est privilégié par les géographes et est considéré comme approprié, investi d’affect et de subjectivité ; il est vécu (lived) (Bonnemaison 1981 : 260). En ce sens, le territoire représente la socialisation de l’espace (Bourdeau 1991 : 29 ; Klauser 2012 : 111). Le rôle des humains et des groupes d’humains est donc crucial dans ce mouvement de « l’espace » vers le « territoire », puisque les territoires sont construits par les humains à travers des actions techniques et des pratiques discursives (Claval 1996 : 97). Raffestin suggère utilement que les arrangements territoriaux constituent une « sémiotisation de l’espace », c’est-à-dire un espace, le monde matériel, progressivement transformé en territoire (Raffestin 1986a : 181, 1986b : 94).
Ces conceptions s’apparentent aux trois ordres de territoire proposés par Di Méo (1998 : 108) : la matérialité, la psyché individuelle (relation émotionnelle et présociale des êtres humains avec la Terre) et les représentations collectives, sociales et culturelles. Les géographes utilisent rarement le second ordre, mais les deux autres se retrouvent fréquemment dans la littérature, car les géographes insistent sur la double dimension, matérielle et idéale, écologique et symbolique, du territoire (Claval 1996 : 97 ; Tizon 1996 : 21 ; Debarbieux 1999 : 36 ; Elissalde 2002 : 195). C’est également le cas pour les trois dimensions du territoire distinguées par Hassner : matérielle, symbolique et fonctionnelle (Hassner in Paasi 2003 : 109). Et l’inclusion de l’immatérialité et de la représentation est exactement ce qui distingue un territoire d’un espace euclidien.
« Le territoire est ce que les gens font pour être ».
Dans les sciences sociales, le territoire est un outil utile pour introduire la logique des agents (Ozouf- Marignier 2009 : 34), puisque, comme le suggère Knight, ce sont « les actions qui donnent un sens au territoire » (Knight 1982 : 517). C’est également le point principal de la contribution de Paasi (2003 : 110) à la première édition de ce Compagnon, puisqu’il considère les territoires comme des « processus sociaux dans lesquels l’espace social et l’action sociale sont inséparables ». Cette idée d’« action sociale » a permis aux géographes francophones, comme le soutient Giraut (2008 : 57), de déplacer l’attention du territoire de l’État vers un territoire aux mains des individus et des multiples collectivités. Le territoire devient le lieu où l’action et la pensée sociale sont possibles, tout en entrant en contact avec la matérialité, en la transformant et en la « déformant » (Di Méo 1991 : 145) (Barel dans Marié 2004 : 90). En ce sens, ce qui est intéressant dans le territoire, c’est qu’il ouvre aux géographes la possibilité d’inverser leur regard de la matérialité à l’immatérialité (ou « semi-sphère », selon le vocabulaire de Raffestin), c’est-à-dire de l’espace aux instruments et aux codes des acteurs qui laissent des traces dans le territoire (Raffestin 1986b : 94). C’est par la prise de conscience de la capacité des individus et des collectivités à modéliser les territoires qu’un glissement s’est opéré dans la géographie francophone : d’un territoire lié à son référent national à un territoire d’appartenances, de projets, de pratiques individuelles et collectives (Giraut 2008 : 57).
C’est en effet lorsque l’idée de projet a commencé à circuler parmi les géographes que le territoire est devenu un « objet fétiche », comme le décrit Giraut (2008 : 61), non seulement pour les géographes culturels et politiques mais aussi pour les géographes économiques en France, qui des années 1950 au « tournant territorial » des années 1980 (Benko 2008 : 38) ont préféré les conceptualisations de l’espace à celles du territoire, trouvant l’espace plus utile pour leur analyse abstraite et quantitative des phénomènes économiques (Benko 2008). Pourtant, la crise économique des années 1970 et l’idée subséquente selon laquelle le « développement » ne peut être suscité par le haut ont fourni l’occasion d’affirmer que la solution à la crise serait de plaider pour une production territorialisée et un développement local, souvent qualifié de « développement territorial » (Giraut 2008 : 61) et soutenu par des revendications locales (Debarbieux 1999 : 38). Ceci est résumé de manière emblématique dans une phrase prononcée par le ministre français du Plan en 1997 et rapportée par Benko (2008 : 41) : « Il n’y a pas de territoires en crise, il n’y a que des territoires sans projets ». Ainsi, les géographes économiques se sont dès lors intéressés à la manière dont les districts spécialisés pouvaient dynamiser l’économie et dont les ressources territoriales pouvaient générer une valeur ajoutée.
Les géographes culturels insistent plutôt sur le premier aspect que Giraut distingue lorsqu’il définit l’appropriation, c’est-à-dire la dimension symbolique du territoire. Bonnemaison, par exemple, soutient que la relation symbolique entre la culture, que d’autres chercheurs appellent « représentations » (Claval 1996 : 102 ; Tizon 1996 : 21) ou « imaginaire » (Tizon 1996 : 21 ; Corboz 2001 : 214), et l’espace, ou la matérialité, se réalise à travers le territoire (Bonnemaison 1981 : 254). En ce sens, le territoire doit être considéré comme un médiateur matériel et symbolique entre un groupe et sa culture (Bourdeau 1991 : 41) ; il s’agit d’un « savant mélange », un savant mélange, de matérialité et d’idéal (Tizon 1996 : 21), dans lequel l’identité joue un rôle important. Claval suggère que les identités se construisent à partir des représentations qui transforment certaines portions de l’espace humanisé en territoires (Claval 1996 : 102). Dans une perspective similaire, Bourdeau soutient que les territoires et les cultures partagées constituent les principales composantes des identités collectives : Si le territoire représente les dimensions spatiales et temporelles de l’identité, la culture reflète les dimensions historiques, mnémoniques et symboliques (Bourdeau 1991 : 42). Cela conduit Bourdeau à affirmer que le territoire est à la fois le miroir culturel d’une identité et le miroir identitaire d’une culture (Bourdeau 1991 : 42) ; un miroir qui tient à l’écart de l’Autre, l’altérité (Piveteau 1995 : 114).
Nous revenons ainsi à Giraut (2008 : 59), qui situe l’« identité » comme le concept pivot pour les géographes culturels pour décrire l’« appropriation » territoriale. Cependant, pour Bonnemaison et Cambrezy (1996 : 13) par exemple, le territoire n’est pas animé par un principe d’appropriation matérielle mais culturelle, c’est-à-dire par « l’appartenance ». L’idée d’appropriation et d’appartenance fait référence à l’utilisation originale du territoire - la traduction en réalités sociales de ce que les éthologues ont observé dans le domaine animal. En s’appuyant sur les considérations faites dans les groupes d’animaux, les chercheurs en sciences sociales ont été appelés à analyser les moyens que les sujets sociaux mettent en œuvre pour contrôler l’espace (Claval 1996 : 95). Pourtant, les spécialistes des sciences naturelles considèrent que le territoire est un environnement auquel les animaux ne peuvent pas échapper, alors que les êtres humains le peuvent grâce à la culture et à un processus de sémiologisation (Raffestin 1986c : 76). A la suite de Tizon (1996 : 34), les sociétés humaines, par rapport aux sociétés animales qui définissent les territoires comme des espaces d’exclusion, peuvent modifier leurs territoires et les transformer, selon leurs aspirations, en lieux de différenciation sociale (voire de ségrégation) ou, au contraire, en lieux de rassemblement et d’appartenance.
C’est en se rassemblant que les gens peuvent utiliser les potentialités inhérentes à l’espace et le transformer en territoire, en mettant en œuvre ces potentialités dans des projets (Bourdeau 1991 : 29). Ainsi, comme le résume Aase : « Le territoire est ce que les gens font pour être » (dans Forsberg 2003 : 10 ; voir aussi Dell’Agnese 2013 : 118). Cela est, évidemment, radicalement différent de la conception taylorienne des territoires et de la territorialité, considérée comme le « lien géographique entre les États et les nations » (Taylor 1995 : 3).
Conclusion
Le cas des Alpes suggère que, même aujourd’hui (ou peut-être surtout maintenant), à une époque où les États semblent être minés (ou du moins remodelés) par les réseaux transnationaux, il y a intérêt à continuer à promouvoir le concept de territoire. Les territoires n’ont pas disparu ; ils sont toujours des « principes incontournables de la vie sociale » (Antonsich 2009 : 801) et ils restent une dimension centrale de la compréhension des manières dont « le « vivre ensemble » est produit, organisé, contesté et négocié » (Antonsich 2009 : 801). Notre compréhension de ceux-ci devrait changer et prendre en compte le fait que « si les territoires sont des portions d’espace relationnel, et non des portions d’espaces homogénéisés abstraits, la qualité de leurs interactions n’est pas un résultat (inéluctable) des caractéristiques essentielles des populations homogénéisées, mais une conséquence de la somme des interactions au sein des individus et entre eux » (Dell’Agnese 2013 : 122-123) ; ou, j’ajouterais, entre les collectivités d’individus.
Bonnemaison est très clair sur ce point lorsqu’il écrit :
L’augmentation de la mobilité et la diminution de la fonction « westphalienne » du territoire ne l’ont pas dépossédé de tout sens ou de toute nécessité. Dans le monde contemporain, le besoin subsiste encore, bien que le territoire prenne des formes différentes et réponde à des fonctions multiples. (Bonnemaison & Cambrezy 1996 : 10)
En ce sens, les chercheurs sont maintenant appelés à analyser comment les idéologies changent à mesure que les logiques territoriales sont remises en question (Murphy 2002 : 198) et à réinterroger le territoire (Elden 2010a : 20). Nous vivons une époque de « complexité territoriale » (Giraut & Antheaume 2005 : 29), de l’épanouissement de « nouvelles régions ». En Europe du moins, le nombre de ce que Deas et Lord (2006) appellent des « arrangements inhabituels » - c’est-à-dire des arrangements territoriaux non liés à l’État territorial - a considérablement augmenté. Selon ces deux chercheurs, l’Europe compte déjà 146 régions transcendant les entités territoriales. Celles-ci ont besoin d’un cadre qui permette de les conceptualiser, comme l’ensemble des processus d’intégration de l’UE en a besoin (Bialasiewicz et al. 2005 ; Clark & Jones 2008). Le territoire francophone pourrait s’avérer être l’outil adéquat pour enrichir ce cadre et donner corps au « plus de travail sur le territoire » que préconise Elden (2010b). Ainsi, les géographes anglophones (et autres) pourraient s’appuyer sur ce que les géographes français appellent le territoire et profiter de nouvelles perspectives pour élaborer ensemble une nouvelle et fascinante théorie du « territoire ».
Références
Voir bibliographie en fin de document pdf
En savoir plus
-
The Wiley Blackwell Companion to Political Geography John A. Agnew (Editor), Virginie Mamadouh (Editor), Anna Secor (Editor), Joanne Sharp (Editor) – October 2015